Jean-Marie Petitclerc, salésien, invité de la matinale de RCF pour parler de la violence chez les jeunes : « Ce que l’on vit aujourd’hui nécessite de la part des adultes d’être beaucoup plus présents »
18 avril 2025

Pierre-Hugues Dubois, présentateur de la matinale de RCF avait choisi comme « invité de la matinale » le 2 avril le père Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco, éducateur, auteur (notamment) du livre « Spiritualité de l’éducation ». En question : la violence chez les jeunes.
Il y a un mois à Paris, il y a trois semaines, c’était à Marseille, la semaine dernière dans l’Essonne… Les meurtres d’adolescents par d’autres adolescents reviennent à fréquence régulière dans l’actualité. Pour quelles raisons observe-t-on une multiplication de violences commises par des mineurs ? Qu’est ce qui les pousse à s’entretuer ? Souvent, les faits à l’origine sont futiles : vol d’un téléphone portable, conflit entre bandes rivales… Le père Jean Marie Petitclerc, éducateur, prêtre salésien, auteur de « Spiritualité de l’éducation » chez DDB et voix de l’antenne grâce aux commentaires de la prière du matin, est au micro de Pierre-Hugues Dubois pour expliquer ce phénomène.
Jean-Marie Petitclerc est une voix bien connue des auditeurs de RCF, grâce notamment aux commentaires de l’évangile.
RCF : Comment expliquez-vous ce nombre de faits divers impliquant des mineurs ?
La guerre des bandes n’est pas un phénomène nouveau. On se souvient de la guerre des boutons. Deux bandes de jeunes issus de territoires différents qui s’affrontent, ce n’est pas nouveau. Ce qui me parait nouveau, c’est que l’on puisse mourir dans le cadre d’une de ces guerres de bandes. Il y a une quarantaine d’années, lorsqu’un gamin était à terre, on avait gagné et on en restait là. Aujourd’hui, on va jusqu’à le tuer à coups de pied, de batte de base-ball ou de couteau.
Ce qui me paraît terrible, c’est le manque d’empathie du jeune face à la victime, la non-prise en compte de la souffrance de l’autre. Là, j’incriminerais un peu l’usage addictif chez certains des écrans, parce que les écrans, le problème, ce n’est pas la violence, c’est la déconnection entre la violence et la souffrance. J’ai un peu l’impression que, chez certains jeunes, tellement habitués à ces scénarios violents qu’ils ne cessent de visionner sur leurs écrans, il peut y avoir une déconnection entre la violence et la souffrance de l’autre. L’impression qu’il va se jouer dans le réel ce qui se joue dans le virtuel.
RCF : Mais l’apparition des écrans ne date pas d’hier…
Ce qui a changé, c’est la progression de la technologie. Il y a dix ans, un jeu vidéo, c’était des silhouettes. Il y avait une perception du virtuel tout à fait différent du réel. Aujourd’hui, quand je surprends un adolescent face à son écran, il me faut un moment de recul pour savoir s’il est en train de visionner un reportage sur la guerre en Syrie ou s’il est en train de jouer à un jeu vidéo, tant le virtuel ressemble au réel.
Et puis il y a ce surcroit de consommation, quand on voit le temps que passe chaque jeune (entre 2 et 3 heures chaque jour) sur les écrans. Aujourd’hui, un collégien, si je fais la somme du temps annuel, passera sur une année, plus de temps face à l’écran qu’à l’école !
RCF : Dès lors, comment adapter votre façon d’éduquer et la mission des éducateurs ?
Je crois que l’éducation à l’empathie doit être une ligne force de la mission de l’éducateur. D’ailleurs, éduquer, c’était aider le jeune à sortir de l’enfance (l’enfant est centré sur lui) et s’ouvrir à l’autre. Combien aujourd’hui il est important de permettre aux jeunes de mettre des mots sur ce qu’ils ressentent.
Vous savez, ces 40 années de pratique d’éducateur m’ont fait découvrir que les jeunes les plus violents sont en quelque sorte des handicapés du langage émotif. Mettre des mots sur ce que je ressens… Tout ce qui va contribuer (théâtre, musique), permettre de mettre des mots sur ces émotions va permettre de développer cette empathie.
Jean Bosco donnait comme 1re consigne à ses jeunes (et ayons bien conscience que la criminalité juvénile était plus forte dans les faubourgs de Turin du 19e siècle qu’elle ne l’est aujourd’hui) de se donner la liberté de courir, de sauter, faire du théâtre, de la musique. Chaque fois que l’on permet à un enfant de mettre des mots, des couleurs, des sons sur ce qu’il ressent, on fait reculer la violence.

RCF : Quels sont les lieux où l’on peut faire cette éducation à l’empathie ?
J’ai envie de dire qu’il ne faut pas le faire à la manière de l’Education nationale : ils repèrent qu’il y a un problème d’empathie, et bien ils disent « on va former des professeurs et on va faire des cours d’empathie ». Non, non ! L’empathie doit se développer par toute la communauté éducative, ça se joue autant sur la cour de récréation qu’ailleurs. C’est un climat à l’intérieur de l’établissement scolaire où les adultes sont attentifs à tout ce qui se joue, à tous ces signaux faibles et sont capables de réagir.
Ce qui me paraît important, c’est aussi de mieux réagir à la primo-délinquance. Deux chiffres : 80% des jeunes sanctionnés à leur premier délit ne récidivent pas. 80% des jeunes incarcérés récidivent dans les six mois qui suivent leur sortie de prison. On entend toujours parler de la prison comme un coup d’arrêt à la violence. Non, c’est avant qu’il faut agir !
Jean Bosco, dans toute sa pédagogie, nous dit que la première qualité de l’éducateur, c’est la présence. S’il n’y a pas cette présence qui va permettre de repérer ces signaux faibles, les premières tensions, alors, effectivement, une spirale de la violence peut se mettre en place. Je crois que ce que l’on vit aujourd’hui nécessite de la part des adultes d’être beaucoup plus présents.
RCF : Vous parlez de la Justice. Qu’est-ce qu’une peine adéquate ?
Jean Bosco parle de la sanction comme d’une correction. On ne peut plus utiliser ce terme aujourd’hui, mais pour lui, la sanction, c’est ce qui doit permettre au jeune de pouvoir corriger son comportement. A la fois de prendre du recul sur les effets de la transgression qu’il a commise et de lui permettre de réparer. C’est ça, une sanction éducative. Elle a un double but : prendre du recul et participer à la réparation. Je ne pense pas que la prison apporte ça, au contraire !
Ce qui est important, c’est l’aspect éducatif de la sanction. Et la sanction du premier délit fait partie de la prévention de la récidive.
RCF : Et l’espérance, père Jean-Marie ?
L’espérance est une dynamique. Nos jeunes ont besoin de ce regard d’espérance des adultes. Ce qui nécessite de ne jamais identifier le jeune à ses comportements d’aujourd’hui. Vous ne m’entendrez jamais parler de jeune délinquant, mais de jeune qui a commis un délit, ou de jeune décrocheur, mais de jeune qui est en situation de décrochage. Les jeunes ont besoin du regard de cet adulte qui ne va pas les enfermer dans la conduite qu’ils ont pu développer à tel ou tel instant de leur parcours d’adolescent.
Et puis regardons l’énergie de ces jeunes ! Prenez le défi du changement climatique ! Le discours que je tiens toujours aux jeunes, c’est bien sûr de ne pas masquer la gravité des problèmes qui se posent à nous, mais de redire la confiance qui est nôtre dans la capacité de cette nouvelle génération de faire face à ces défis.
Pour écouter l’émission :
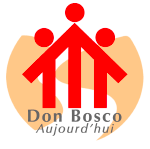


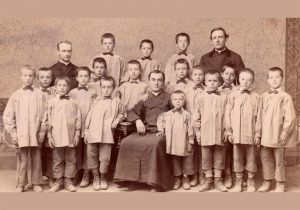
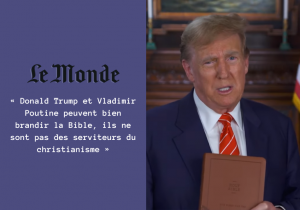


![Pédagogie salésienne de Don Bosco : la confiance [PODCAST]](https://www.don-bosco.net/wp-content/uploads/2025/04/Voix-salesienne-300x210.png)