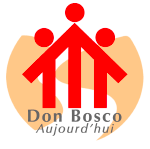Jean-Marie Petitclerc dans « La Vie » : « La médiation reste la grande oubliée des politiques publiques dans les quartiers »
31 juillet 2023

Entretien paru dans La Vie.

Père Jean-Marie Petitclerc.
Photo : Claude Truong-Ngoc
Alors que les banlieues se sont embrasées fin juin à la suite du décès de Nahel, le prêtre salésien Jean-Marie Petitclerc, éducateur spécialisé auprès des jeunes des quartiers, revient sur les échecs et succès des politiques publiques concernant ces territoires.
Cela fait presque trente ans qu’il s’investit dans l’accompagnement des jeunes de cités, depuis qu’il a fondé en 1995 l’association Valdocco au pied des tours d’Argenteuil. Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, a cherché durant toute sa vie professionnelle d’éducateur spécialisé et de directeur d’établissement pour adolescents confiés par l’Aide sociale à l’enfance, à faire vivre l’intuition du fondateur de sa congrégation, Jean Bosco : montrer aux jeunes qu’ils ont un avenir et une place dans la société. Cette quête l’a même mené quelques mois au ministère du Logement et de la Ville.
Auteur de plusieurs ouvrages sur la jeunesse, il est aujourd’hui vicaire provincial des Salésiens de Don Bosco pour la France et la Belgique Sud. Pour La Vie, il revient sur les événements ayant suivi la mort du jeune Nahel, habitant du quartier Pablo-Picasso à Nanterre, et sur les politiques publiques concernant les banlieues françaises.
Fin juin, des émeutes ont éclaté dans plusieurs banlieues de France. Qu’en avez-vous pensé ?
Ceux qui suivent la vie dans les banlieues disent depuis longtemps que la situation n’est pas résolue. Or elle n’a fait l’objet d’aucun sujet dans les dernières campagnes législatives et présidentielles ! Tous les spécialistes alertent pourtant sur le fait que les choses peuvent dégénérer d’un moment à l’autre, sans savoir ce que sera le déclencheur. Cela a été le tragique décès de Nahel.
La colère qui s’est déchaînée ensuite est à interpréter avec précision. Beaucoup de jeunes se sont d’abord identifiés à Nahel et ont exprimé leur colère car ils craignent qu’un jour cela puisse leur arriver à eux aussi. Ensuite, il y a eu, dans la violence que l’on a vue, une manière de parler socialement : certains se sont dit que ce n’est qu’en agissant ainsi, qu’en brûlant autour d’eux, que la société les regarde et se soucie de leurs conditions de vie. Enfin, il y a eu la violence d’opportunité que l’on voit chez ceux qui pillent et volent au milieu des émeutes. Il faut entendre ces colères et réagir fermement aux actes de destruction posés mais ne pas les mélanger comme un tout, sans quoi on ne peut les comprendre.
Comment avez-vous reçu les appels à la responsabilité des parents que l’on a beaucoup entendus, de la part de politiques entre autres ?
On a beaucoup parlé des pères pendant ces émeutes et de leur absence. On oublie que beaucoup d’entre eux ont été les émeutiers des années 1990 et ceux des années 2005. Quand ils ont vu leurs enfants exprimer ainsi leur colère, on a perçu une compréhension de leur part, d’où une absence de réaction dans un premier temps. Mais quand on en est arrivé aux scènes de pillage, j’ai vu leur position changer : dans une vidéo, un père va chercher son ado et le ramène de force. J’en ai vu d’autres agir ainsi.
On utilise beaucoup l’expression de parents démissionnaires mais pour moi, on peut parler de parents qui ont été démissionnés par notre société. Ces parents issus de l’immigration par exemple, portaient le travail au cœur de leur système de valeur : c’est pour cette valeur-là qu’ils avaient quitté leur pays. Lorsqu’ils se sont retrouvés massivement au chômage, tout ce système de valeur s’est effondré chez eux : beaucoup de ces hommes qui avaient tant prôné la valeur travail n’étaient plus en mesure de le faire légitimement devant leurs enfants, étant exclus du monde du travail. On n’a pas suffisamment pris conscience que le chômage massif a entraîné une telle décrédibilisation des pères – statistiquement, c’est le double de la moyenne nationale dans les quartiers populaires, c’est énorme !
Accuser les pères aujourd’hui ne réglera pas le problème. L’éducateur que je suis sait combien, pour exercer une situation d’autorité auprès des jeunes, il faut être crédible.
Vous êtes éducateur spécialisé. En 1995, vous vous installez à Argenteuil, en pleine cité, et vous créez l’association Valdocco : pourquoi ?
L’idée a été de reprendre les intuitions de Jean Bosco. Dans les faubourgs de Turin, il a été confronté à une criminalité juvénile plus forte que celle que nous connaissons. Il voulait proposer une éducation intégrale : dans le Valdocco, il a créé un centre de loisirs et une école. En partant de cette expérience, nous avons développé un modèle qui investit les loisirs, comme peut le faire le patronage, mais aussi l’école et la famille, le tout en simultanée.
Quel est le modèle de cette association ?

Aide aux devoirs au Valdocco.
Nous avons observé que les jeunes passent par trois lieux, la famille, l’école et la rue avec les copains, mais que chacun est marqué par une culture différente. La culture familiale est empreinte des traditions d’origine, la culture scolaire des traditions républicaines, et celle de la rue est devenue une culture de l’entre-jeune, les adultes ayant déserté l’espace public. Or il est dur, pour les gamins, de construire leur personnalité, leur identité en passant d’une culture à une autre, alors que les adultes référents dans chacune d’entre elles ne tiennent pas le même discours. Un enfant me disait, qu’après l’assassinat de Samuel Paty, ce qu’on lui disait à l’école était l’inverse des propos tenus par ses parents : « Qui croire ? », me demandait-il.
Le maître-mot de l’association Valdocco est, depuis trente ans, de vouloir rejoindre les jeunes dans ces trois lieux car leur comportement est différent lorsqu’ils se situent au sein de la fratrie, dans un groupe encadré par des adultes, ou dans la bande de quartier. Nous avons donc une présence dans la rue avec des actions d’animation, puis une présence à l’école avec de la prévention du décrochage scolaire et la prise en charge des jeunes exclus temporairement. Ce dernier cas de figure est très important car quand un enfant pose problème sur le plan comportemental, la réponse est l’exclusion, logiquement : or il se retrouve alors avec tous les copains déscolarisés comme lui ! Être présent à ce moment-là est fondamental.
Enfin, nous faisons du soutien à la parentalité. Bon nombre de parents sont dépassés : ils me disent que leurs enfants sont plus sensibles à l’injonction reçue par les réseaux sociaux que la leur. Il faut les soutenir, pas les montrer du doigt ou les dénigrer.
Depuis les années 1990, les pouvoirs publics disent vouloir répondre à « la crise des banlieues ». Ce problème est-il considéré sérieusement ?
Le paradoxe, ces trente dernières années, est qu’on est prêt à dépenser un argent fou pour enfermer les enfants mais pas pour prévenir la délinquance ! Le cœur de notre action est la médiation, c’est-à-dire tenter de créer du lien entre les différents adultes qui cheminent auprès des enfants. On a retrouvé cet esprit, emprunté au Valdocco, dans le programme de réussite éducative défini dans le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo en 2004, alors ministre de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, concrétisé l’année d’après. Mais il s’est retrouvé comme un dispositif supplémentaire parmi les autres, et les moyens sont très faibles. Je le dénonce souvent avec les associations de prévention : nous avons le plus grand mal à maintenir les crédits politiques de la ville.
Surtout, je crois que les gouvernements font deux erreurs d’analyse. La première est de penser que la crise des banlieues est un problème d’urbanisme et de concentration. On a dépensé des milliards pour recréer des espaces, détruire des logements dégradés et en construire d’autres. Mais on a oublié la mixité sociale : on s’est retrouvés avec la même population d’un endroit à un autre. La deuxième erreur est de flécher tous les crédits pour des actions dans les quartiers, pour des gens du quartier : cela n’enraye pas la ghettoïsation.
Pendant un an, entre 2007 et 2008, vous avez rejoint le ministère du Logement et de la Ville. Quel regard portez-vous sur cette expérience ?
J’ai beaucoup appris sur la manière dont se vivent les choses en politique. J’ai regretté l’opposition qu’il y a eue entre la ministre du Logement et de la Ville de l’époque pour qui je travaillais, Christine Boutin, et Fadela Amara, alors secrétaire d’État chargée de la politique de la ville. Les visions étaient opposées : nous voulions sortir de cette logique de quartier quand elle estimait indispensable que les financements soutiennent les projets dans les quartiers.
Quels sont les axes à mettre en œuvre, de manière plus large et plus volontariste, selon vous, pour apporter des solutions ?
Il faut miser sur la mixité sociale pour sortir de la crise des banlieues. Cela passe par une refonte de la carte scolaire en n’obligeant plus les enfants des quartiers à aller à l’école au même endroit. Cet enfermement social touche même les programmes de vacances : on finance des actions pour emmener les jeunes d’une banlieue ensemble, ailleurs, sans qu’ils échangent avec les jeunes d’autres territoires.
L’urgence est de passer d’une politique des quartiers prioritaires à une véritable politique de la ville, celle-ci devant s’appuyer sur des actions recréant des circulations entre les quartiers, ceux du centre-ville et ceux des banlieues. Je dis souvent aux maires qu’il vaut mieux une ligne de bus directe entre un quartier et la mairie plutôt que construire une mairie annexe au pied des tours.
Aujourd’hui, je suis heureux d’entendre des politiques dire qu’il faut revoir la carte scolaire. Scolariser les enfants avec les caïds qui leur font peur et les copains qui ne cessent de rigoler ne les met pas dans la meilleure situation d’apprentissage ! Sans compter la grande différence entre un collège de centre-ville et un établissement de quartier, qui est que, dans le premier, il est encore valorisant d’être premier de classe alors que dans le second, c’est dangereux. Je rencontre des enfants prodigieusement intelligents qui vont sacrifier leur scolarité pour sauver leurs alliances. Le facteur majeur d’échec du programme Zep que les autorités publiques développent depuis 30 ans tient à cet oubli : celui qu’à 13 ou 14 ans, exister pour le regard des copains passe avant le fait d’être reconnu par l’institution.
Vous avez pris votre retraite professionnelle en 2014. Quelles sont les actions que vous avez menées et qui contribuent à améliorer la situation ?

Inauguration du Valdocco de Nice, en 2013.
Je suis heureux du modèle de prévention développé au Valdocco. Mais j’ai aussi créé, la même année en 1995, l’Association pour la promotion des métiers de la ville qui forme à la médiation (Promevil). C’est la plus grosse association de médiateurs d’Île-de-France aujourd’hui.
Avez-vous remarqué qu’après ces quelques jours d’émeutes début juillet, on a si peu parlé du retour au calme ? Car il est bien revenu. Qu’est-ce qui l’a permis ? Certains ont évoqué la présence policière, mais on a bien vu au départ que cela ne suffisait pas ; d’autres ont parlé des dealers ; je crois, moi, que cela est venu du travail des médiateurs. Sur le quartier Pablo-Picasso à Nanterre, les équipes de Promevil étaient auprès des enfants et adolescents après l’explosion de colère, œuvrant alors à une stratégie de retour au calme. J’ai commencé à promouvoir la médiation à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines dans les années 1990, avec le maire de cette ville Pierre Cardo à l’époque, dans le contexte d’une cité en crise.
La médiation reste la grande oubliée des politiques alors que c’est ce dont on a le plus besoin. Elle est un chemin pour réaliser la mixité sociale. Nous avons besoin de professionnels de la médiation qui connaissent les deux cultures, celle institutionnelle et celle des quartiers, pour rétablir les liens. Les médiateurs créent des ponts. J’entends que la priorité serait d’enfermer les jeunes. Qui peut croire que cela va changer quoi que ce soit au problème ?
L’Église est-elle au rendez-vous des défis dans les banlieues ?
Malheureusement pas suffisamment… Nous n’avons que très peu entendu d’évêques début juillet. Les petites communautés religieuses qui, jusque-là, jouaient un rôle important dans ces lieux, sont parties, à cause du vieillissement et de l’islamisation, sans un regard de la part de l’Église qui les considéraient peu. La promotion de la fraternité ne me semble pas toujours être une priorité des séminaristes et jeunes prêtres, ce que je déplore. D’autres initiatives voient le jour : un ancien éducateur du Valdocco a fondé l’association Le Rocher par exemple.
Vous êtes vicaire provincial des Salésiens de Don Bosco pour la France et la Belgique Sud. Quels sont les défis pour votre congrégation ?
Nous avons deux types d’œuvres : des écoles, majoritairement des lycées professionnels, technologiques et agricoles ; le réseau Don Bosco Action Sociale que je coordonne et qui comporte une centaine d’établissements et de service pour la jeunesse en difficulté dans tous les secteurs de la prise en charge (Valdocco, École et Culture à Mantes-la-Ville, un club de prévention dans la banlieue de Bordeaux, tout le secteur de la protection de l’enfance, celui de la protection judiciaire de la jeunesse, les plateformes d’accueil de mineurs non accompagnés).
Le grand défi est de redonner à chaque jeune une vraie place dans la société, de lui permettre de se projeter dans l’avenir. Eux rêvent d’aventure ! Certains sont partis aux émeutes comme pour un jeu scout, jouant à cache-cache avec les policiers… Mais qu’est-ce qu’on leur propose d’autres ? À nous, adultes, de les accompagner pour qu’ils trouvent des voies autres que la casse et la destruction, qu’ils retrouvent le sens de leur place dans une société qui leur signifie qu’elle compte sur eux et qu’elle a besoin d’eux.